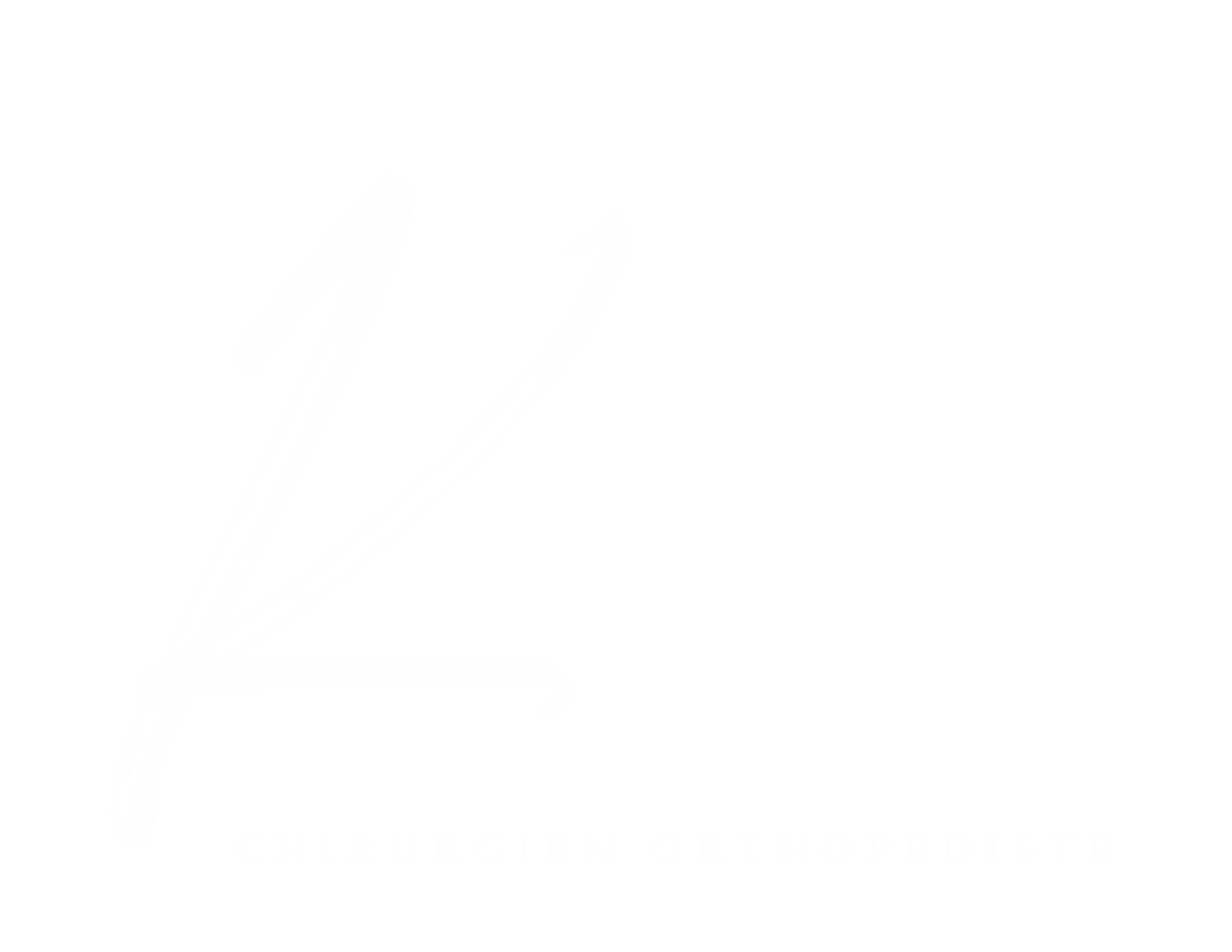Les différents types de prothèses de genou : standard, révision et charnière
La prothèse totale de genou (PTG) est une intervention très fréquente et efficace pour soulager les douleurs liées à l’arthrose ou à d’autres pathologies articulaires. Cependant, il n’existe pas une seule prothèse totale de genou : plusieurs modèles sont disponibles, chacun adapté à la situation du patient, à la stabilité du genou et à l’état des ligaments.
Dans cet article, nous détaillons les différents types de PTG — de la prothèse de première intention à la prothèse de révision charnière — afin d’expliquer leur principe et leurs indications.
1. La prothèse totale de genou de première intention
Principe
Il s’agit de la prothèse standard, posée lors d’une première intervention pour traiter une arthrose du genou avancée ou une arthropathie destructrice.
L’objectif est de remplacer les surfaces articulaires usées (fémur, tibia, parfois la rotule) par des implants métalliques séparés par un insert en polyéthylène, permettant un mouvement fluide et indolore.
Selon l’état des ligaments, plusieurs sous-types existent :
Prothèse à conservation du ligament croisé postérieur (PCL) : le ligament est préservé pour conserver une biomécanique naturelle.
Prothèse hyper congruente : les ligaments croisés sont remplacés par la forme de l’insert qui est creusé.
Prothèse postéro-stabilisée (PS) : les ligaments croisés sont remplacés par un système mécanique intégré à la prothèse de type came
Prothèse semi-contrainte : utilisée si les ligaments sont fragiles ou partiellement déficients.
Indications
Arthrose fémoro-tibiale étendue ;
Polyarthrite rhumatoïde ou arthropathies inflammatoires ;
Déformation du genou modérée (genu varum, valgum) ;
Raideur douloureuse après arthrose évoluée.
Ces prothèses offrent d’excellents résultats lorsque les ligaments sont fonctionnels et que l’anatomie osseuse reste conservée.
2. La prothèse totale de genou de révision
Principe
Une prothèse de révision est indiquée lorsqu’une prothèse précédente doit être remplacée, en raison d’un descellement, d’une infection, d’une usure de l’insert, ou d’une instabilité.
La chirurgie de révision est plus complexe, car il faut retirer l’ancien implant et souvent reconstruire les pertes osseuses avant de poser la nouvelle prothèse.
Les implants de révision sont plus contraints que les prothèses standard :
Ils disposent de tiges intramédullaires pour une meilleure fixation dans l’os sain ;
Ils peuvent comporter des cales pour compenser les pertes osseuses ;
Le système d’articulation est souvent plus stabilisé (le plot de l’insert est plus gros pour assurer une meilleure stabilité dans le plan frontal), pour compenser l’absence de certains ligaments.
Indications
Descellement mécanique de la prothèse (perte d’ancrage osseux) ;
Infection prothétique nécessitant une reprise chirurgicale ;
Usure de l’insert ou des composants ;
Instabilité chronique du genou après prothèse ;
Fracture péri-prothétique (autour de l’implant).
Ces prothèses de révision permettent de redonner une articulation stable et fonctionnelle dans des situations où une prothèse classique ne suffit plus.
3. La prothèse de genou charnière
Principe
La prothèse charnière est la forme la plus contrainte des prothèses de genou. Elle relie mécaniquement le fémur et le tibia par un axe central, reproduisant le mouvement d’une charnière articulée.
Cette conception permet d’assurer une stabilité totale même en l’absence de ligaments, au prix d’une plus grande rigidité mécanique.
Indications
La prothèse charnière est réservée aux cas complexes où la stabilité du genou ne peut plus être obtenue autrement :
Reprises multiples après plusieurs interventions ;
Destruction ligamentaire totale (ligaments croisés et collatéraux) ;
Pertes osseuses importantes du fémur ou du tibia ;
Reconstruction après infection sévère ;
Tumeurs osseuses nécessitant une résection étendue.
Elle est donc principalement utilisée en chirurgie de révision complexe ou en chirurgie oncologique.
4. Comment choisir le bon type de prothèse ?
Le choix du type de prothèse dépend de plusieurs critères :
L’état des ligaments (croisés et collatéraux) ;
La quantité d’os disponible pour la fixation ;
Le contexte (première opération ou reprise) ;
Les antécédents d’infection ;
Les objectifs fonctionnels du patient.
L’évaluation préopératoire (imagerie, bilan fonctionnel, antécédents) permet au chirurgien orthopédiste d’opter pour la solution la plus adaptée, en privilégiant la stabilité, la mobilité et la durabilité du résultat.
Conclusion
La prothèse totale de genou n’est pas un modèle unique : elle s’adapte à chaque situation.
La PTG de première intention est la plus fréquente et permet d’excellents résultats en cas d’arthrose évoluée.
Les prothèses de révision et charnières, quant à elles, sont des solutions spécialisées, destinées aux cas complexes, offrant une seconde chance de retrouver confort, stabilité et mobilité après échec ou usure d’un implant précédent.